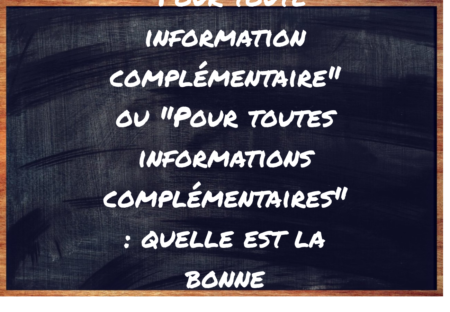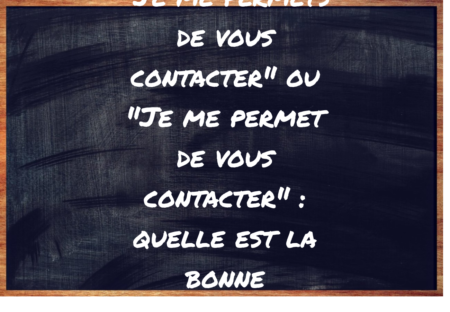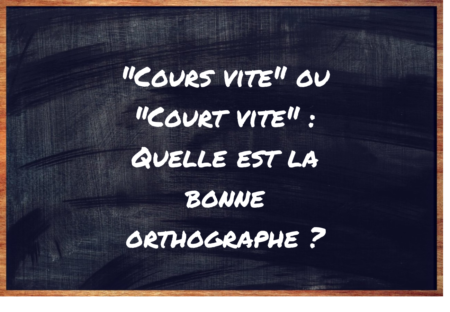Faut-il dire Madame la maire, Madame le maire ou même Madame la mairesse ? Si vous vous posez encore la question, sachez que vous n’êtes pas seul. Ce débat linguistique et politique revient régulièrement dans les médias, les institutions… et même au sein des conseils municipaux. Alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses à présider des mairies en France, l’usage des titres reste flou pour beaucoup. Voici de quoi vous y retrouver.
Sommaire
En résumé : que faut-il dire en 2025 ?
Forme recommandée :
✅ Madame la maire (correct, moderne, clair)
Forme alternative :
✔️ Madame la mairesse (correct mais perçu comme vieilli ou régional)
Forme tolérée mais en déclin :
❌ Madame le maire (traditionnel mais plus en phase avec l’évolution de la langue)
Quelle est la bonne formule : « Madame le maire », « la maire » ou « la mairesse » ?
Aujourd’hui, les trois formulations coexistent dans la langue française, mais elles ne se valent pas toutes. Et surtout, elles ne sont pas neutres.
Selon les linguistes et les recommandations officielles, la forme à privilégier est bien : 👉 Madame la maire
C’est la formule qui respecte à la fois la grammaire, l’usage moderne et la reconnaissance des femmes dans les fonctions politiques. Elle est aujourd’hui préconisée dans les documents administratifs, dans la presse nationale, et par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes.
Autre alternative, « Madame la mairesse » est correcte, bien que moins usitée en France métropolitaine. Le mot, tombé un temps en désuétude, fait un timide retour dans certains territoires — et reste parfaitement officiel en Suisse, en Belgique et au Québec.
Quant à « Madame le maire », c’est la formule traditionnelle, encore utilisée par certaines élues, mais elle tend à reculer face aux évolutions linguistiques et sociétales.

VOIR AUSSI : « Meilleures salutations » ou « Meilleurs salutations » ?
Une féminisation progressive… et tardive
Un combat ancien pour une langue plus égalitaire
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la langue française a déjà connu des formes féminines pour les titres et fonctions dès le Moyen Âge. On disait sans difficulté mairesse, autrice, philosophesse… avant que ces formes ne soient progressivement effacées à partir du XVIIe siècle avec la masculinisation systématique des rôles de pouvoir.
La troisième vague de masculinisation, selon la professeuse et militante Éliane Viennot, s’est même accentuée au XXe siècle, à mesure que les femmes accédaient aux fonctions jusque-là réservées aux hommes. Ironique, non ?
Le tournant des années 80 et la circulaire de 1998
En France, sous l’impulsion des mouvements féministes, la féminisation officielle des noms de métiers et de fonctions commence timidement dans les années 1980, notamment dans la fonction publique.
La circulaire du Premier ministre du 6 mars 1998, toujours en vigueur, demande aux administrations d’utiliser les formes féminines des fonctions occupées par des femmes, conformément aux recommandations de la Commission de terminologie.
Depuis, la tendance s’est confirmée. Le terme « mairesse » figure désormais dans le Larousse comme désignant non seulement l’épouse du maire, mais aussi une femme exerçant cette fonction.

VOIR AUSSI : Comment bien écrire « Je vous prie d’agréer » ?
La position (évolutive) de l’Académie française
Historiquement réticente, l’Académie française a longtemps soutenu la forme « Madame le maire », estimant que maire est un nom masculin, quel que soit le sexe de la personne.
Mais le vent a tourné. Dans un rapport publié en mars 2019, l’Académie admet un « décalage entre les réalités sociales et leur traduction dans le langage ». Elle reconnaît désormais que :
« Les mots qui se terminent par un -e muet, comme maire, juge, comptable, artiste, peuvent naturellement être utilisés au féminin sans modification. »
Ainsi, « la maire » devient tout à fait recevable, au même titre que « la juge » ou « la ministre ». L’Académie souligne néanmoins que certaines femmes préfèrent encore être appelées Madame le maire — et que ce choix personnel peut être respecté.
Ce que disent les élues elles-mêmes
Nombreuses sont les femmes élues qui militent pour la féminisation de leur titre. À commencer par Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, qui insiste :
« Je tiens à ce que tous les services utilisent Madame la maire. Il est temps de nommer les femmes pour ce qu’elles sont. »
De son côté, Anne Vignot, maire écologiste de Besançon, tranche sans détour :
« On dit Madame la maire, point. »
Même son de cloche pour Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique, qui voit dans la féminisation de la langue un marqueur positif de l’évolution des mentalités.

VOIR AUSSI : « Disponible pour un entretien » ou « Disponible pour une entrevue » ?
Et « mairesse », alors ? Mot vieilli ou outil de visibilité ?
Si certains entendent encore par mairesse « l’épouse du maire », cette acception est aujourd’hui dépassée, et jugée même sexiste par de nombreuses voix.
Éliane Viennot propose de réhabiliter pleinement ce mot, utilisé depuis le XIXe siècle en France et toujours actif dans d’autres pays francophones. D’ailleurs, au Québec, Valérie Plante est officiellement désignée comme « la mairesse de Montréal », sans que cela ne choque qui que ce soit.
Alors, pourquoi pas en France ?
Comment s’y retrouver ? La règle d’or : demander à la principale intéressée
En fin de compte, le plus simple reste de demander à l’élue comment elle souhaite être appelée. C’est d’ailleurs la ligne officielle de l’Académie française, via son spécialiste Patrick Vannier du service du dictionnaire :
« Il n’y a pas de règle unique. La meilleure chose à faire est de s’adresser à la personne en respectant sa préférence. »
Madame la maire : un usage moderne, correct et respectueux
Aujourd’hui, si vous devez écrire une lettre officielle, présenter une élue en conseil municipal ou dans un journal, « Madame la maire » est la formule recommandée.
Elle respecte :
- la grammaire française actuelle
- les recommandations administratives
- le principe d’égalité femmes-hommes
Quant à « mairesse », son usage reste possible dans des contextes moins formels, ou si la personne concernée le revendique. En revanche, « Madame le maire » devient de plus en plus minoritaire — même si elle persiste encore dans certaines régions ou générations.
La langue française, reflet des évolutions sociétales
Ce débat dépasse largement la simple grammaire. Il interroge la place des femmes dans la sphère publique, la manière dont on reconnaît leur rôle, et la façon dont le langage peut accompagner ou freiner l’égalité.
Comme le souligne Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter, dans une chronique :
« C’est dans la langue que commence le respect. »
Et dans ce cas précis, il commence par trois petits mots : Madame la maire.