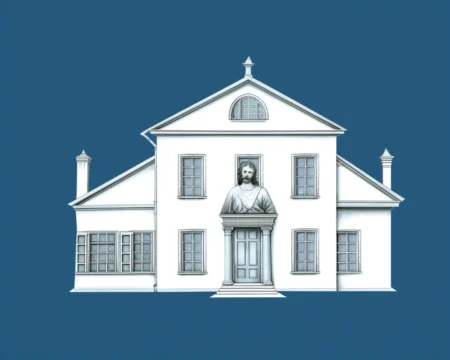En 2020, 10 millions de pauvres étaient recensés par le Secours catholique. Ce seuil de pauvreté, toutefois, ne permet pas de visualiser dans son entièreté la notion de pauvreté. Au-delà de l’argent, la pauvreté se manifeste également par l’absence d’accessibilité aux services de base comme à l’éducation ou à l’emploi. C’est ce qui marque la fracture sociale au sein de nombreux pays, un pan humanitaire qu’il est temps de remettre au cœur des priorités.
Sommaire
Qu’est-ce qu’une fracture sociale ?
Ce terme ne se popularise que dans les années 90, tout particulièrement en 95 lors de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Il s’inspire d’une analyse sociologique d’Emmanuel Todd, constatant un malaise depuis le début des années 80 au sein de la société française. La fracture sociale, c’est l’idée qu’une frange de la population se voit séparée d’une autre par un fossé social.
D’un côté, certains s’intègrent en société et ont les éléments nécessaires pour parvenir à y évoluer. De l’autre, des individus se trouvent victimes d’exclusion sociale. Cette exclusion sociale est un phénomène ancien, mais conceptualisé dans les années 80. Il définit les individus qui se retrouvent mis en marge de la société, du plus grand groupe, à cause d’un mode de vie trop différent.
Cette nuance de vécu, toutefois, est généralement de causes sociales, liées à une grande pauvreté. Elle se remarque sensiblement dans des pays du tiers-monde, et de nombreuses associations telles que DISSE luttent, au quotidien, afin d’atténuer ces différences sociales. Pourtant, même au plus près de chez soi, la fracture sociale divise les populations.
Les sociologues alertent sur l’urgence d’agir contre la pauvreté
C’est une priorité pour de nombreux experts. La fracture sociale semble s’être normalisée, délaissée des pouvoirs publics et de l’opinion médiatique, alors qu’elle continue d’être plus importante que jamais. Les différences entre les populations riches et pauvres semblent, en effet, s’être accentuées lors des dernières années. La crise sanitaire, envahissant tous les continents du monde, a continué de marquer la rupture entre les populations.
Les sociologues insistent : se référer au simple seuil de pauvreté ne suffit pas à se faire une vision complète de la pauvreté réelle vécue. Il y a, de fait, un ensemble de facteurs à prendre en compte, tels que les indicateurs de position sociale ou l’accès à un réseau familial ou amical aidant.
Ces recherches, rappellent-ils, n’ont pas pour simple objectif d’identifier les pauvres. Il est question, surtout, de réussir à regrouper les acteurs publics pour redonner confiance aux personnes. Ils se lamentent de l’absence de la fracture sociale à l’ordre du jour, alors que c’est un concept plus qu’applicable aujourd’hui.
Nouvelle-Calédonie, un exemple alertant des inégalités sociales
Il suffit de faire un arrêt sur l’île calédonienne pour se rendre compte de la fracture sociale qui agite lourdement les populations. Nouméa faisait partie, en 2019, des 20 villes les plus chères du monde. Elle s’apparente alors à Paris ou Hong-Kong. Les habitants limitent au strict minimum leurs achats, tentent de cultiver au possible sur leurs bouts de jardin ou balcons.
Alors que le pays évolue, proposant des allocations familiales et logement, par exemple, la fracture sociale demeure des plus ancrées. 20 % de la population perçoit 8,4 % des revenus des 20 % les plus modestes. Un ratio faisait près du double de celui en Métropole. Ce sont près de 50 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et, pour une majorité d’entre elles, issues de la communauté kanake.
Cette population, particulièrement, s’est vue plus encore fragilisée dans les derniers mois, victimes du variant Delta. C’est une situation qui ne fait que renforcer l’opinion des experts. Délaisser le concept politique de fracture sociale, alors même que son impact empire une situation sanitaire, déjà terrible, n’est plus une possibilité. Dans un futur proche, il sera nécessaire de se mobiliser à nouveau.